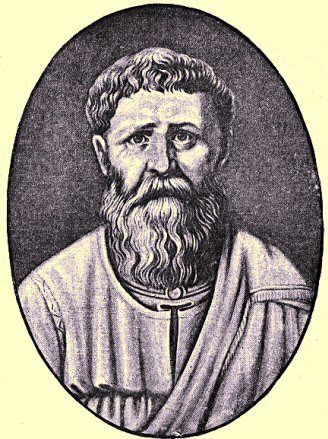CLVIII
Mais aussi quand j'avais une fois ma chère petite brioche, et que, bien enfermé dans ma chambre, j'allais trouver ma bouteille au fond d'une armoire, quelles bonnes petites buvettes je faisais là tout seul, en lisant quelques pages de roman ! Car lire en mangeant fut toujours ma fantaisie, au défaut d'un tête-à-tête. C'est le supplément de la société qui me manque. Je dévore alternativement une page et un morceau : c'est comme si mon livre dînait avec moi.
– Jean-Jacques Rousseau
Trop souvent les plaisirs du corps et les plaisirs de l'intellect sont arbitrairement séparés, comme s'il y avait une telle différence de nature entre eux qu'ils ne pouvaient se mêler dans un même désir et dans une même action. La manière dont nous désirons lire contredit directement cette séparation arbitraire. Leçon de Deleuze : le désir est complexe, il est agencé avec des éléments hétérogènes, et il est toujours artificiel d'isoler l'un de ces éléments lorsqu'on l'on souhaite exprimer notre désir. L'excès d'abstraction serait nuisible dans ce sujet qui demande du concret ; aussi, je m'y plonge, et avec délectation. Mes lectures, je les associe à des moments de la journée et à des lieux très précis ; non pas tous, mais mes livres les plus chers, mes livres de chevet, sont profondément liés à ces éléments extérieurs qui accompagnent et stimulent mon envie de lire. Alain, c'est toujours le matin que je le lis, en prenant mon petit-déjeûner ; je ne conçois pas une lecture réellement plaisante des Propos sans ma tasse de café et mon jus d'orange ; c'est ainsi. Je crois qu'il ne s'agit pas d'un hasard, si c'est cet auteur que je lis le matin ; par nature, Alain réveille, il force son lecteur à éveiller son esprit en même temps que les vitamines B du jus d'orange éveillent le corps ; et, procédant ainsi, j'ai l'impression de respecter le mouvement de ses Propos, car, plus qu'à n'importe quelle autre moment de la journée, nous savourons le quotidien le matin, à l'aube, lorsque nous pensons qu'un nouveau jour se lève. Voilà ce que j'aime dans la lecture d'Alain le matin : à chaque nouveau lever de soleil correspond l'émergence d'une nouvelle pensée.
Je n'aime point sacraliser l'objet du livre ; je me ris de ceux qui prennent leurs bouquins comme des reliques qu'ils n'osent abîmer ; et c'est joyeusement que je contemple les miettes et les traces de café ou de vin qui parsèment un nombre considérable de mes livres. De même, aussi singulier que cela puisse paraître, j'aime découvrir, en feuilletant un livre déjà lu, un poil traînant de-ci de-là, entre deux belles phrases : c'est signe que je suis passé par là, et non seulement mon esprit, mais également mon corps. L'état de mon bouquin de Deleuze sur Spinoza et le problème de l'expression, qui pourrait sembler appartenir à un ivrogne, me rappelle l'une de ces heureuses soirées solitaires dans lesquels âme et corps unifiés se plongent dans l'ivresse ; Bach, Spinoza par Deleuze, une bouteille de Languedoc et un homme dans l'enthousiasme, heureuse combinaison. Sans doute que la philosophie m'eût paru plus austère si des verres de Ricard et de Picon ne m'eussent pas régulièrement accompagnés dans son exploration.