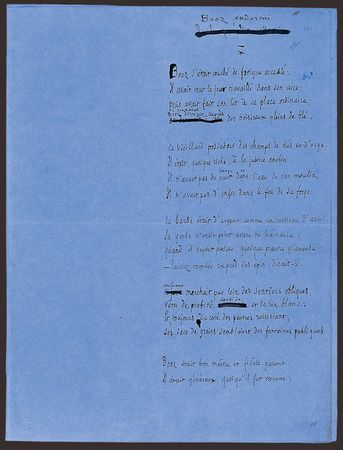CCXCIX
C'est le silence qui les réveille. Un silence étrange. Plus profond que d'habitude ; plus silencieux que les silences auxquels ils sont habitués.
– Jean Giono
Il n'est pas vrai que l'arrivée du sommeil exige toujours un total silence. Je dirais plutôt que chaque homme est habitué à sa petite musique nocturne, qu'il chérit et dont il peut difficilement se passer ; cette musique est une variation sur le silence. La condition du bon sommeil, c'est l'innatention ; Morphée est ennemi de concentration et d'étonnement ; or, tout ce qui dérange les habitudes du corps réveillent concentration et étonnement. Il m'est arrivé de prêter ma chambre à un ami, et de la retrouver avec ma chaleureuse horloge arrêtée. Pourtant, cette horloge est tout à fait plaisante ; un coq enthousiaste est dessiné dessus ; en revanche, son tic-tac régulier n'est pas discret. Mon ami ne pouvait pas dormir avec ce bruit qui le rendait fou, me disait-il. Quant à moi, qui dort tous les jours avec mon coq horloger, je ne remarque même pas cette austère musique et n'y pense jamais.
J'ai pris l'habitude de dormir avec un fond sonore depuis mon adolescence lorsque je me plaisais à écouter des émissions quelconques à la radio en éteignant ma lumière. Quoique je puisse dormir très bien sans cela, car, n'étant pas du genre anxieux ou obsédé, j'ai le sommeil facile, j'ai gardé l'habitude d'écouter toujours quelque chose avant de m'endormir. Les Nocturnes de Chopin m'ont conduit un nombre étonnant de fois jusqu'au royaume du frère jumeau de Thanatos. Les cours de Deleuze ont davantage nourri mon sommeil que mon entendement : j'avais tellement pris l'habitude de m'endormir à la voix de Deleuze que lorsque je l'écoutais au milieu de l'après-midi, je ne pouvais m'empêcher de faire une sieste. Bien des fois j'ai écouté le même cours, ne me souvenant plus du tout de ce que le célèbre philosophe séducteur avait raconté avant que je ne perde conscience. Je ne suis pas toujours aussi négligent avec mes conférenciers : connaissant ma capacité hors du commun à m'endormir à leurs voix, je m'assure désormais de les écouter en me couchant une heure avant que ne passe le ponctuel wagon de Morphée, ce qui, du reste, ne m'empêche pas de le prendre bien souvent en avance. Ces voix qui exposent un concept philosophique, qui racontent un événement de l'histoire, qui lisent un roman ou un poème, elles me bercent dans la nuit comme l'harmonieuse suite de notes de Chopin, Bach et Monteverdi. Il y a un moment où les paroles d'un conférencier cessent d'être des phrases chargées de sens pour devenir un flux indécomposable de sons indistincts, une mélopée sourde et suave, un peu semblable au tic-tac de mon coq horloger ; à ce moment, je ne suis plus attentif à rien, mon entendement m'abandonne, ma pensée s'allège, et, doucement, agréablement, je m'endors. Le silence de mes nuits est une rassurante musique humaine.