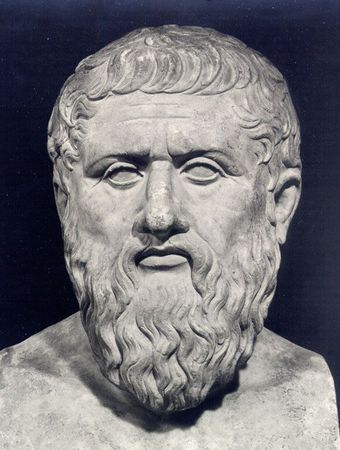Sous cette expression de sensus communis on doit comprendre l’Idée d’un sens commun à tous, c’est-à-dire d’une faculté de juger, qui dans sa réflexion tient compte en pensant (a priori) du mode de représentation de tout autre homme, afin de rattacher pour ainsi dire son jugement à la raison humaine tout entière et échapper, ce faisant, à l’illusion, résultant de conditions subjectives et particulières pouvant aisément être tenues pour objectives, qui exercerait une influence néfaste sur le jugement.
– Kant

Pour ne pas faire du jugement de goût un jugement de l'entendement objectif, nécessaire, a priori, à valeur universelle, fondée sur une connaissance démontrable par des concepts de perfection, selon la thèse rationaliste et dogmatique, ni un jugement tiré de la seule imagination, jugement subjectif, relatif, a posteriori, n'ayant aucune prétention à l'universel, selon la thèse empiriste et sceptique, Kant déploie pour son compte le concept de sens commun (sensus communis). De fait, l'originalité de Kant et son apport majeur dans la philosophie esthétique vient de ce qu'il sut résoudre l'opposition traditionnelle entre la thèse qui affirme que tous les goûts sont dans la nature et que nous ne devons pas en discuter, et la thèse selon laquelle il y a une vérité nécessaire et objective du jugement de goût que l'on pourrait démontrer par l'entendement : en liant le sens commun au goût, Kant peut définir ce dernier comme la faculté de juger, sans médiation d'un concept, de ce qui est beau, c'est-à-dire de ce qui procure un plaisir universellement communicable. L'usage par Kant d'un tel concept de sens commun, en l'appliquant uniquement au jugement esthétique et en le débarrassant de son sens moral ou logique, n'est pas sans poser problème et sans avoir de conséquences pour la manière de concevoir le jugement de goût, et c'est ce qui va nous intéresser ici.
Le sens commun, appliqué au goût, est, pour Kant, un principe subjectif : le jugement de goût n'est jamais un jugement de connaissance, bien que l'entendement joue un rôle dans ce jugement et que ce jugement a une prétention à l'universel. Pourquoi séparer le jugement de goût du jugement de connaissance ? Qu'est-ce qui sépare ces deux sortes de jugement ? Le jugement de connaissance est fondé sur l'entendement (Verstand), entendement discursif qui est une faculté des concepts. Or, le jugement de goût ne saurait reposer sur les concepts. De fait, l'expérience montre que lors de la contemplation esthétique, ce n'est pas par des concepts que nous trouvons une satisfaction, un plaisir ; ce serait dénaturer, altérer le jugement esthétique, qui ne peut qu'être pur ; au contraire, lorsque nous éprouvons un sentiment de plaisir en contemplant un objet, non seulement il nous est impossible de trouver des concepts pour légitimer ou justifier notre plaisir, mais, spontanément, nous ne cherchons même pas ces concepts. C'est que nous rapportons la représentation de l'objet par l'imagination (qui est liée malgré tout, comme nous le verrons, à l'entendement), et c'est l'imagination, en tant qu'elle est une faculté de présentation, qui nous procure le sentiment de plaisir ou de déplaisir ; le jugement de goût n'est jamais un jugement de connaissance, un jugement logique, car le sentiment de plaisir ne se rapporte pas à l'objet, mais au sujet en tant qu'il est affecté par l'objet en question. D'après Kant, c'est faire une véritable confusion que d'assimiler les jugements de goût à des jugements de connaissance fondés sur des concepts : « Si l'on juge et apprécie les objets uniquement par concepts, on perd toute représentation de la beauté. » Penser ainsi, c'est oublier que le sentiment de plaisir, qui caractérise la faculté de juger esthétique, est fondé sur le sujet, et que cette faculté ne saurait donc qu'être subjective, alors que l'entendement est une faculté fondée sur l'objectivité, de sorte que si, pour essayer de savoir si un objet est beau, nous nous fondons sur des raisonnements ou des principes, donc sur l'entendement et sur des concepts, nous sautons précisément à côté de ce que nous cherchions.
Néanmoins, pour que le goût ne se résume pas à un sentiment strictement personnel, valable pour un seul individu, Kant fait intervenir le concept de sens commun, concept qu'il élabore en précisant que le jugement de goût se fonde sur la correspondance a priori entre le sujet et une représentation, c'est-à-dire que que l'imagination du sujet réfléchit un objet, et c'est cette représentation réfléchie de la forme qui, dans le jugement esthétique, cause le sentiment de plaisir ; mais cette correspondance a priori entre le sujet et la représentation ne serait pas possible s'il n'y avait que l'imagination qui jouait un rôle, si l'entendement ne participait pas au jugement de goût. Or, c'est précisément de cet accord entre les facultés que vient un sens commun esthétique. Si l'imagination, en réfléchissant un objet, ne se rapporte pas à un concept déterminé de l'entendement, si elle ne subsume aucune représentation sous des concepts de l'objet, elle se rapporte en revanche à un concept indéterminé de l'entendement ; et c'est dans l'indétermination de ce concept de l'entendement que réside l'accord entre les deux facultés, accord sans lequel on ne pourrait parler de libre jeu entre l'imagination et l'entendement : si l'imagination devait se rapporter à un concept déterminé de l'entendement, il n'y aurait pas de libre jeu possible. Le libre jeu entre l'entendement et l'imagination rend possible la prétention du jugement de goût à l'universalité et à la nécessité : en effet, l'imagination, libre en tant qu'elle schématise sans concepts, en s'accordant avec l'entendement, qui permet la conformité à une loi, permet de juger un objet d'après la finalité de la représentation. En effet, ce n'est certainement pas les agréments des sens ni le concept perfection ou de bien qui peuvent fonder le jugement de goût, mais la finalité subjective dans la représentation, finalité sans fin ni objective ni subjective ; autrement dit, il s'agit d'une finalité sans fin, une finalité formelle. Or, comme cet accord entre les facultés qui permet le jugement de goût par la finalité sans fin de la représentation est un principe a priori, il s'applique à tous les êtres humains, et tous leurs jugement de goût prétendent ainsi à la validité universelle.
Le jugement de goût se fonde sur un principe a priori, mais également sur un principe subjectif, ce qui l'amène à se différencier et de la thèse relativiste et de la thèse rationaliste : le jugement de goût est un jugement désintéressé et réfléchissant, ne donnant pas de connaissance sur l'objet mais ne donnant pas non plus une simple sensation purement subjective. L'originalité de la théorie kantienne du jugement de goût est qu'elle se situe entre un accord emprique et sensible, et une universalité provenant de règles rationnelles. Comment cela est-il possible ? Cela est possible, d'une part, parce que Kant refuse la thèse rationaliste selon laquelle le jugement de goût se fonderait sur un ensemble de bonnes règles que l'entendement aurait à appliquer ; en effet, cela reviendrait à dire que le goût peut s'apprendre, idée que refuse Kant et dont l'expérience montre la fausseté clairement : ce n'est pas parce que quelqu'un connaît les règles du bon goût qu'il aura nécessairement un bon goût, et un théoricien de l'art peut tout à fait révéler avoir moins de goût qu'un homme n'ayant jamais entendu parler des règles classiques du goût. Si l'on suit cette thèse jusqu'au bout, elle révèle que nous pourrions rendre compte rationnellement et légitimer nos jugement de goût, et ainsi démontrer leur vérité grâce à notre entendement : c'est croire naïvement que le beau peut être compris à partir de concepts déterminés, alors qu'il ne peut qu'être senti ; c'est confondre jugement de goût et jugement de connaissance, car seul ce dernier type de jugement peut être démontré par l'entendement à partir de principes, de règles, de concepts déterminés et objectifs. Ainsi, cette thèse apparaît insoutenable, ne serait-ce que lorsqu'on cherche à la vérifier dans l'expérience : il est par trop évident que si les hommes se disputent sur le beau, ce n'est pas parce que quelques uns d'entre eux n'ont pas su assimiler et appliquer des règles objectives – ce serait éluder le problème du jugement de goût, confondre art et science, comme si l'on pouvait réfuter le jugement de goût de quelqu'un comme l'on réfute une théorie scientifique erronée, et tomber ainsi sous la critique pertinente des sceptiques, des relativistes et des empiristes. Mais, d'autre part, si les critiques des sceptiques sont pertinentes, dans la mesure où ils rappellent que le jugement de goût est fondamentalement subjectif et qu'on ne saurait parvenir à un consensus universel en tentant de démontrer le bien-fondé de son jugement de goût, il est également insoutenable de soutenir sérieusement que chacun peut avoir son propre goût (« À chacun son goût » dit le proverbe), car cela reviendrait précisément à nier l'existence du goût, qui ne peut exister que si une diversité de jugement esthétique peuvent coïncider pour former un consensus minimum. D'ailleurs, là aussi, l'expérience montre que si les hommes peuvent souvent se disputer à propos de goût, ils peuvent tout aussi souvent avoir les mêmes sentiment de plaisirs devant la même œuvre d'art ; il paraît, en effet, bien difficile de prétendre, par exemple, que la Joconde est laide ou que la Toccata et fugue en ré mineur de Bach est une mauvaise musique... Le beau ne saurait donc être une affaire strictement personnel, dont on ne pourrait pas partager l'expérience avec les autres hommes ; d'ailleurs, si les hommes se disputent à propos du beau, c'est bien qu'ils ne peuvent accepter qu'un objet puisse être dit beau uniquement pour eux seuls, mais qu'ils pensent que chacun devrait considérer l'objet en question comme étant beau. Comment donc Kant fit-il pour trouver un « mi-chemin » entre ces deux thèses extrêmes ?
De fait, Kant ne tombe ni dans le premier excès rationaliste, puisqu'il ne cesse d'affirmer, comme nous l'avons vu, que le jugement de goût n'est pas fondé uniquement sur l'entendement, mais qu'il s'appuie d'abord sur l'imagination, ce qui inscrit le jugement de goût dans la subjectivité ; il ne tombe pas non plus dans le second excès sceptique, puisque le goût réside sur le sens commun, fondé sur le libre jeu entre l'entendement et l'imagination, d'où découle un sentiment de plaisir ayant une prétention à la validité universelle. Il en résulte que le goût, pour Kant, échappe aux deux thèses réductrices énoncées plus haut qui constituent l'antinomie du goût exposée par Kant dans la Dialectique du jugement esthétique, puisque le goût apparaît comme la faculté de juger esthétique réfléchissante, idée qui réunit une partie des deux thèses, lesquelles ne sont contradictoires qu'en apparence. Le concept de goût ne signifie plus un mode de connaissance, puisqu'il se fonde sur le jugement réfléchissant et la finalité formelle, qui, s'ils se rapportent forcément à la représentation d'un objet singulier, n'apportent pas de connaissance à proprement parler sur l'objet en question. Par suite, le goût n'est pas non plus purement subjectif, ce qui serait retourner à la thèse empiriste : il serait tout à fait faux de réduire le jugement de goût à une « pure réaction subjective, comme celle que déclenche l'excitation de l'agréable sensible ». Le jugement de goût, pour Kant, est nécessairement désintéressé, sans quoi il ne saurait être pur puisqu'il inclurait des éléments qui fausseraient le jugement de goût ; il convient donc de différencier l'agréable du beau ; en effet, si je peux dire qu'un morceau de chocolat est agréable, en tant qu'il me procure une sensation de plaisir, il serait absurde d'en conclure que le morceau de chocolat est beau. Ainsi, lorsque nous contemplons une brioche peinte par Chardin ou la Vénus de Milo, alors que ces deux œuvres représentent des objets pouvant susciter notre agrément, notre faim, pas plus que notre désir sexuel, n'est excité. Si l'on peut parler de « goût réfléchi », ce n'est pas parce que le goût est purement subjectif et que la contemplation suscite des impressions agréables pour nous, mais parce que le goût est fondé sur le jugement subjectif et sur l'harmonie libre entre la faculté de l'imagination, faculté qui rend possible les jugements réfléchissants, et la faculté de l'entendement.
Le sens commun chez Kant prend une signification très différente de la signification morale et politique de ce concept, ce qui influe sur la conception du jugement de goût, sans pour autant que le goût soit entièrement détaché de toute forme de socialité. Gadamer, dans Vérité et Méthode, indique que Kant sépare le concept de sens commun de son sens habituel tiré de la tradition politique et morale. Gadamer rappelle que le concept de sens commun trouve son origine dans l'idéal humaniste de l'éloquentia, dont on peut trouver les germes dans la conception antique du sage ; c'est un concept qui se rapproche de la prudence (φρόνησις) aristotélicienne et qui se fonde moins sur la vérité que sur la vraisemblance, permettant à chacun de s'orienter dans la communauté politique et dans la vie. Ainsi, le concept de sensus communis est fondamentalement pratique, utile pour la vie quotidienne, qui s'oppose avec la spéculation abstraite des théoriciens. Or, comme nous l'avons vu, le sensus communis, en se rapportant au goût, finit par avoir chez Kant un sens précis qui diffère de la signification traditionnelle de ce concept, puisque, comme le rappelle Gadamer, Kant invoque le sens commun pour exprimer l'universalité qui est à l’œuvre dans les jugements de goût venant du libre jeu des facultés. Le jugement de goût, fondé sur le sensus communis, bien qu'il soit subjectif, inclut néanmoins la sphère de la socialité, c'est-à-dire que l'expérience du beau n'est pas un phénomène strictement personnel, n'ayant aucune influence sur la communauté, ou ne pouvant être apprécié en groupe, bien au contraire. Il faut être attentif à cette nuance, faisant que le jugement de goût chez Kant est une expérience irréductiblement inscrite dans le sujet éprouvant du plaisir ou du déplaisir, mais qui est une expérience qui veut être partagé avec les autres êtres humains. Par ailleurs, le goût esthétique se définit moins positivement que négativement : avoir du goût consiste avant tout à ne pas prendre du plaisir à la contemplation de représentations jugées grossières, laides par le sens commun : le goût est fait de mille dégoûts dira Paul Valéry ; avoir du goût, c'est essentiellement éliminer et discriminer, et non pas faire preuve d'un goût supérieur qui pourrait fonder une communauté – Kant se refuse à aller jusque là.
En quoi alors le sens commun esthétique se rapporte t-il encore chez Kant à la socialité ? Le paragraphe 60 de la Critique de la faculté de juger, concernant la méthodologie du goût, est à ce titre éclairant. En effet, Kant y indique ce que pourrait être une propédeutique du goût, laquelle ne saurait évidemment pas, pour des raisons qui sont maintenant évidentes, consister en l'apprentissage d'une méthode avec prescription de règles et principes rationnels ; en revanche, il peut y avoir une manière (modus) pour les beaux-arts, et, par suite, une propédeutique efficace consisterait plutôt à exalter l'imagination, à lui mettre devant les yeux les exemples de la beauté ; c'est en cela que consiste les humanoria. De là peut découler le concept de culture, dans lequel les beaux-arts occupent une place privilégiée : en effet, c'est en contemplant les œuvres des génies du passé, ces génies qui singularisent les peuples et qui permettent l'unification de ceux-ci (qu'on pense au rôle unificateur de l'Iliade et de l'Odyssée dans la Grèce antique), que l'on constitue un véritable fil entre son jugement de goût subjectif et la communauté à laquelle on appartient, voire à l'humanité toute entière : en tant que le sens commun permet la constitution de modèles communs de beauté, on peut dire que le goût chez Kant continue à être rapporté à la socialité. Par suite, Kant finit par lier le goût et son apprentissage avec l'apprentissage des Idées morales, ce qu'il peut justifier en rappelant qu'il existe, non pas certes une correspondance, mais au moins une analogie, entre le goût et les Idées morales ; c'est par ce rapprochement du goût avec la morale que les êtres humains peuvent fixer des modèles immuables et déterminés. Par là, et c'est pourquoi cette méthodologie du goût est dans la Critique de la faculté de juger un appendice, Kant sort du jugement pur du goût et de sa détermination transcendantale, c'est-à-dire non déterminé par quelque chose d'empirique : la socialité n'est donc pas contenue dans le cœur de la théorie esthétique de Kant, puisqu'elle ne dérive pas d'un principe a priori, mais constitue un prolongement de sa théorie.
Kant apporte, dans la Critique de la faculté de juger, un nombre considérable d'innovations dans la manière de concevoir le jugement de goût, mais également dans son élaboration du sens commun qui devient, avec Kant, proprement esthétique, acquérant ainsi un sens précis différent de sa signification politique et morale traditionnelle. Il semble que le concept de sensus communis du goût, tel qu'il est développé par Kant, permet d'échapper aux excès des thèses sceptiques et des thèses rationalistes sur le goût : fondé sur le jugement réfléchissant et sur le libre jeu de la faculté de l'imagination et la faculté de l'entendement, étant ainsi subjectif tout en ayant une prétention à la validité universelle, le jugement de goût, chez Kant, est admirablement souple et féconde et permet de penser d'une manière nouvelle le problème du jugement esthétique. On voit qu'il y a des problèmes propres à l'élaboration de cette théorie du jugement de goût, ainsi que les changements, les remodelages apportés par Kant à certains concepts ; par là, nous voyons que la théorie kantienne du goût n'a rien d'évident en soi, et qu'elle est le fruit d'un travail d'élaboration philosophique remarquable ; les concepts philosophiques, pour être déployés au service d'une théorie, se doivent d'être finement et longuement taillés comme le forgeron qui aiguise une épée pour en faire une arme efficace.